
Back نشاطية متراخية Arabic Activisme de sofà Catalan Slacktivismus Czech Slacktivisme Danish Slacktivism German Slacktivism English Activismo de sillón Spanish مبارزه زیر لحاف Persian סלקטיביזם HE Սլեքթիվիզմ Armenian


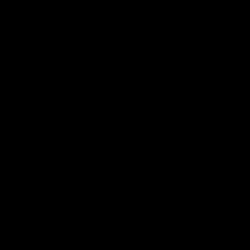

Le slacktivisme (littéralement « activisme paresseux »), mot-valise formé par la fusion du terme anglais slacker (« fainéant ») et du mot « activisme », est une forme de militantisme sur Internet qui s'est développé dans les années 2000 avec l'avènement des réseaux sociaux et qui consiste à cliquer pour participer à un mouvement collectif virtuel sans s'engager plus activement et concrètement.
Les campagnes de Twibbon menées sur Twitter, les pétitions en ligne ou, en guise de soutien, le partage d'un tweet (re-tweet), le changement de sa photo de profil ou le like sur Facebook en sont des illustrations. Ce cybermilitantisme porte d'autres vocables : clictivisme, slackertivisme, fauteuil révolutionnaire, bénévolat virtuel[1]. Le slacktivisme peut aussi se manifester sous la forme de port d'un habit d'une couleur en particulier, d'un bracelet coloré, voir d'un badge ou d'un pin's[2].
Le terme a été créé en 1995 par Dwight Ozard et Fred Clark[3].
- ↑ Lucie Lavoie, « Un clic pour une cause », sur cursus.edu,
- ↑ (en) Laura Seay, « Does slacktivism work? », Washington Post, (lire en ligne)
- ↑ « Le "slacktivisme", ce concept qui pourrait relancer la participation des jeunes aux élections », sur Le HuffPost, (consulté le )
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search