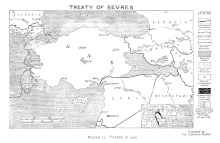Back Turuki Utsmani ACE Осмэн Пачъыхьыгъо ADY Ottomaanse Ryk Afrikaans Osmanisches Reich ALS የኦቶማን መንግሥት Amharic Imperio Otomán AN Oþomanisce Rīce ANG الدولة العثمانية Arabic الدولة لعتمانية ARY امبراطوريه عثمانيه ARZ
دَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْمَانِیَّه / devlet-i ʿaliyye-i ʿos̲mâniyye
–
(623 ans, 3 mois et 5 jours)
 (1793-1844)  (1844-1922) Drapeau de l'Empire ottoman |
 Armoiries de l'Empire ottoman (1882-1922) |
| Devise | en turc ottoman : دولت ابد مدت (devlet-i ebed müddet, « L’État éternel ») |
|---|
| Statut |
|
|---|---|
| Capitale |
Söğüt (–) Bursa (–) Andrinople (Edirne) (–) Constantinople (–) |
| Langue(s) |
Turc ottoman (officielle) Arabe (administrations et gouvernements locaux, religieux, culture, littérature, diplomatie et éducation) Persan (littérature, diplomatie et éducation) Français (langue étrangère de l'enseignement moderne et des relations extérieures pendant l'ère post-Tanzimat/le dernier empire)[4] |
| Religion | Islam sunnite (officielle), soufisme, chi'isme, christianisme, yézidisme et judaïsme (minoritaires) |
| Monnaie | Akçe, kuruş, livre |
| Population | |
|---|---|
| • 1600 | ~ 30–35 000 000 habitants |
| • 1856 | ~ 35 350 000 habitants |
| • 1906 | ~ 20 884 000 habitants |
| • 1914 | ~ 18 520 000 habitants |
| • 1918 | ~ 14 629 000 habitants |
| Superficie | |
|---|---|
| • 1299 | ~ 9 000 km2 |
| • 1326 | ~ 16 000 km2 |
| • 1362 | ~ 95 000 km2 |
| • 1683 | ~ 5 200 000 km2[5] |
| • 1900 | ~ 3 400 000 km2[6] |
| Conquête de Bilecik | |
| Prise de Constantinople | |
|
Abolition du sultanat Partition de l'Empire |
|
| Proclamation de la république de Turquie | |
| Abolition du califat |
| Premier | Osman Ier |
|---|---|
| Dernier | Mehmed VI |
| Premier | Alaeddin Pacha |
|---|---|
| Dernier | Ahmet Tevfik Pacha |
Entités précédentes :
 Sultanat de Roum
Sultanat de Roum Empire byzantin
Empire byzantin- Despotat de Serbie
 Sultanat mamelouk du Caire
Sultanat mamelouk du Caire Sultanat hafside de Tunis
Sultanat hafside de Tunis Zianides
Zianides Karamanides
Karamanides Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes
Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes Royaume croate
Royaume croate Second Empire bulgare
Second Empire bulgare Empire de Trébizonde
Empire de Trébizonde Aq Qoyunlu
Aq Qoyunlu Sultanat de Sennar
Sultanat de Sennar Royaume de Bosnie
Royaume de Bosnie Dobrogée valaque
Dobrogée valaque Bessarabie moldave
Bessarabie moldave Principauté de Théodoros
Principauté de Théodoros Despotat de Morée
Despotat de Morée Duché de Naxos
Duché de Naxos Ligue de Lezha
Ligue de Lezha
Entités suivantes :
 République de Turquie
République de Turquie Grèce
Grèce Royaume d'Égypte
Royaume d'Égypte Soudan anglo-égyptien
Soudan anglo-égyptien Principauté de Serbie
Principauté de Serbie État d'Abdelkader
État d'Abdelkader Algérie française
Algérie française Régence de Tunis
Régence de Tunis Protectorat français de Tunisie
Protectorat français de Tunisie Principauté de Bulgarie
Principauté de Bulgarie Royaume de Roumanie (en Dobrogée)
Royaume de Roumanie (en Dobrogée) Chypre britannique
Chypre britannique Bosnie-Herzégovine austro-hongroise
Bosnie-Herzégovine austro-hongroise Libye italienne et Dodécanèse italien
Libye italienne et Dodécanèse italien Gouvernement provisoire d'Albanie
Gouvernement provisoire d'Albanie Territoires ennemis occupés
Territoires ennemis occupés Mandat britannique en Irak, Koweït et Hasa
Mandat britannique en Irak, Koweït et Hasa Royaume du Yémen
Royaume du Yémen Royaume du Hedjaz
Royaume du Hedjaz Empire russe (en Crimée, Caucase, Boudjak)
Empire russe (en Crimée, Caucase, Boudjak)
L'Empire ottoman (en turc ottoman : دولت عليه عثمانیه / devlet-i ʿaliyye-i ʿos̲mâniyye, littéralement « l'État ottoman exalté » ; en turc : Osmanlı İmparatorluğu ou Osmanlı Devleti[a]), connu historiquement en Europe de l'Ouest comme l'Empire turc[8], la Turquie[9], ou bien la Turquie ottomane[10],[11], est un empire fondé à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de l'Anatolie, dans la commune de Söğüt (actuelle province de Bilecik), par le chef tribal oghouze Osman Ier, fondateur de la dynastie ottomane (ottoman vient de l'arabe ʿuṯmānī عُثْمَانِي, dérivé de ʿuṯmān عُثْمَان, nom arabisé d'Osman)[12]. (Ottoman vient également de Ataman, nom turcisé d’Osman). Après 1354, les Ottomans entrèrent en Europe, et, avec la conquête des Balkans, le Beylik ottoman se transforma en un empire transcontinental. Après avoir encerclé puis réduit sa capitale en lambeaux, les Ottomans mirent fin à l'Empire byzantin en 1453 par la conquête de Constantinople sous le règne du sultan Mehmed II[13].
Aux XVe et XVIe siècles, sous le règne de Soliman Ier le Magnifique, l'Empire ottoman était un empire multinational et multilingue contrôlant une grande partie de l'Europe du Sud-Est, des parties de l’Europe centrale, des parties de l’Europe de l'Est, des parties de l'Asie occidentale, du Caucase et de l'Afrique du Nord. Au début du XVIIe siècle, l'Empire comprenait trente-deux provinces et de nombreux États vassaux. Certains d'entre eux ont ensuite été absorbés par l'Empire ottoman, tandis que d'autres bénéficièrent de divers types d'autonomie au cours des siècles[b].
Avec Constantinople comme capitale, et le contrôle des terres autour du bassin méditerranéen, l'Empire ottoman fut au centre des interactions entre les mondes oriental et occidental pendant six siècles. Alors que l'on croyait autrefois que l'Empire était entré dans une période de déclin à la suite de la mort de Soliman le Magnifique, cette opinion n'est plus soutenue par la majorité des historiens universitaires. L'Empire continua à maintenir une économie, une société et une armée puissantes et flexibles tout au long du XVIIe et d'une grande partie du XVIIIe siècle[15],[16],[17].
Les Ottomans subirent de graves défaites militaires à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, ce qui les amena à entamer un vaste processus de réforme et de modernisation connu sous le nom de Tanzimat. Ainsi, au cours du XIXe siècle, l'État ottoman était devenu beaucoup plus puissant et organisé malgré de nouvelles pertes territoriales, en particulier dans les Balkans où de nouveaux États émergèrent[18]. L'Empire s'allia à l'Allemagne au début du XXe siècle, espérant échapper à l'isolement diplomatique qui avait contribué à ses récentes pertes territoriales, et s'engagea ainsi dans la Première Guerre mondiale du côté des puissances centrales[19]. Peu préparé à participer à une guerre moderne, l'empire dut également affronter d'importantes tensions internes, en particulier dans ses possessions arabes, avec la révolte arabe de 1916-1918. Pendant ce temps, des exactions furent commises par le gouvernement ottoman, dont certaines de nature génocidaire contre les Arméniens[20], les Assyriens, et les Grecs[21].
La défaite de l'Empire et l'occupation d'une partie de son territoire par les puissances alliées au lendemain de la Première Guerre mondiale entraînèrent sa partition, et la perte de ses territoires du Moyen-Orient divisés entre le Royaume-Uni et la France, selon des mandats de la Société des Nations, dans l’attente de l’indépendance des territoires considérés : Palestine, Mésopotamie (futur Irak), Syrie et Liban. Le succès de la guerre d'indépendance turque contre les occupants alliés conduisit à l'émergence de la république de Turquie, proclamée le dans le cœur de l'Anatolie à Ankara, et à l'abolition de la monarchie ottomane[22].
- (en) « Ottoman Empire », sur encyclopedia.com (consulté le ).
- https://www.worldhistory.org/Ottoman_Empire/
- https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-padisahlari/
- Johann Strauss et Malek Sharif, The First Ottoman Experiment in Democracy, Wurtzbourg, Orient-Institut Istanbul (de), , 21–51 p. (lire en ligne), « A Constitution for a Multilingual Empire: Translations of the Kanun-ı Esasi and Other Official Texts into Minority Languages » (page d'information concernant le livre dans l'Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg) // CITÉ: p. 26 (PDF p. 28/338). « French had become a sort of semi-official language in the Ottoman Empire in the wake of the Tanzimat reforms.[...]It is true that French was not an ethnic language of the Ottoman Empire. But it was the only Western language which would become increasingly widespread among educated persons in all linguistic communities. »
- Peter Turchin, Jonathan M. Adams, Thomas D. Hall: East-West Orientation of Historical Empires and Modern States. In: Journal of World-Systems Research, vol. XII, no II, 2006, p. 218–239 et 223. PDF
- Klaus Kreiser: Der Osmanische Staat 1300–1922. Oldenbourg, Munich, 2008, (ISBN 3-486-58588-6), S. 8.
- Johann Strauss et Malek Sharif, The First Ottoman Experiment in Democracy, Wurtzbourg, Orient-Institut Istanbul (de), , 21–51 p. (lire en ligne), « A Constitution for a Multilingual Empire: Translations of the Kanun-ı Esasi and Other Official Texts into Minority Languages » (page d'information concernant le livre dans l'Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg) // CITÉ: p. 36 (PDF p. 38/338).
- Hamish Scott, The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350–1750 : Volume II, (lire en ligne), p. 612.
- Svat Soucek, Ottoman Maritime Wars, 1416–1700, Istanbul, The Isis Press, , 8 p. (ISBN 978-975-428-554-3).
- Raphaela Lewis, Everyday Life in Ottoman Turkey, Dorset Press, , 206 p. (ISBN 978-0-88029-175-0, lire en ligne).
- Godfrey Goodwin, Ottoman Turkey, Scorpion Publications, (lire en ligne).
- Caroline Finkel, Osman's Dream : The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923, Basic Books, , 660 p. (ISBN 978-0-465-02396-7), p. 2 et 7.
- Quataert 2005, p. 4.
- Marine Turque : Site officiel : « Atlantik'te Türk Denizciliği ».
- Gábor Ágoston et Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, , « Introduction », xxxii.
- Faroqhi 1994, Crisis and Change, 1590–1699, p. 553.
- Virginia Aksan, Ottoman Wars, 1700–1860 : An Empire Besieged, Pearson Education Ltd., , 130–135 p. (ISBN 978-0-582-30807-7, lire en ligne).
- Faroqhi 1994, The Age of Reforms, 1812–1914, p. 762.
- (en) Carter Vaughn Findley, Turkey, Islam, Nationalism and Modernity : A History, 1789–2007, New Haven, Yale University Press, , 200 p. (ISBN 978-0-300-15260-9).
- Quataert 2005, p. 186.
- (en) Dominik J Schaller et Jürgen Zimmerer, « Late Ottoman genocides: the dissolution of the Ottoman Empire and Young Turkish population and extermination policies—introduction », Journal of Genocide Research, vol. 10, no 1, , p. 7–14 (DOI 10.1080/14623520801950820).
- Douglas A. Howard, A History of the Ottoman Empire, Cambridge University Press, (lire en ligne), p. 318.
Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « alpha », mais aucune balise <references group="alpha"/> correspondante n’a été trouvée
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search